Haiti-Culture
Historique de la St Valentin
HISTORIQUE DE LA ST-VALENTIN
St-Valentin, patron des amoureux, est en fait un prêtre mort martyrisé par les Romains, le 14 février 270. |
|
À cette époque Valentin s'attira la colère de l'empereur Claude II qui venait d'abolir le mariage. En effet l'empereur trouvait que les hommes mariés faisaient de piètres soldats parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leur famille. Claude ne reculant devant rien abolit le mariage. |
|
Valentin encourage alors les jeunes fiancés à venir le trouver en secret pour recevoir de lui la bénédiction du mariage. Il fut arrêté et emprisonné.Pendant qu'il attend son exécution dans sa prison, Valentin se prend d'amitié pour la fille de son geôlier et lui redonne la vue. Juste avant d'être décapité, il lui offre des feuilles en forme de COEUR avec le message suivant : DE TON VALENTIN! (Est-ce pour cela que l'on dit que l'amour est aveugle et qu'il fait perdre la tête?) |
|
|
|
LES LUPERCALESAvant même Valentin, il existait une fête païenne célébrée à la mi-février: Les Lupercales romaines. Pendant cette fête les adolescents devaient se soumettre à un rite d'initiation . Chaque jeune homme pigeait le nom d'une jeune fille qui lui était assignée pour l'année.En 496, le pape interdit cette fête très peu respectueuse pour les femmes. Il choisit alors Valentin comme patron des amoureux et décrète le 14 février jour de sa fête. |
|
Les cartes de St-Valentin Quand le tirage au sort des Lupercales fut aboli, les jeunes gens de Rome prirent une autre habitude beaucoup plus romantique. Cette coutume consistait à offrir à la femme de leurs rêves des voeuxaffectueux.La plus ancienne carte que l'on connaisse fut envoyée par Charles, duc d'Orléans alors qu'il était emprisonné à la Tour de Londres. En effet, il envoya à sa femme une carte contenant un poème d'amour.Au 19e siècle le service postal devient un moyen de communication plus rapide et moins dispendieux. on s'en sert donc pour envoyer nos voeux. Il devient alors même possible d'envoyer anonymement des cartes et on en vit apparaître des libertines. Dans certains pays, les choses tournèrent même à l'obscénité, à tel point qu'il fallut les interdire.CupidonDans la mythologie romaine, Cupidon représente le dieu de l'amour. Il est personnifié par un jeune enfant peu vêtu, muni d'un arc et d'une flèche. On croit que, lorsqu'une de ses flèches vous touche, vous tombez follement amoureux de la première personne que vous rencontrez.Le chocolatDe nos jours on donne surtout du chocolat. Pourquoi? Certains prétendent que ce choix n'est pas dû au hasard. En effet, des chercheurs ont découvert qu'il existe une hormone du désir amoureux, la phényléthylamine que l'on retrouve également dans le chocolat.Les 'XXX" pour signifier des baisersLorsqu'on inscrit ces "XXX" à la fin d'une lettre d'amour, on ignore généralement qu'il s'agit là d'une coutume remontant aux débuts du catholicisme où le X représentait la croix, symbole de foi jurée.La croix a eu longtemps aussi valeur de signature car peu de gens savaient écrire. Lorsque l'on signait d'un X on devait embrasser la croix, ce qui avait valeur de serment.C'est donc de cette pratique du baiser de la croix que vient le X symbolisant le baiser.ET MAINTENANTÀ l'origine Valentin n'a voulu que signifier son attachement à une personne qui lui est chère. Il est déplorable qu'avec le temps la Saint-Valentin soit devenue une fête commerciale.Cet événement devrait plutôt être l'occasion de manifester son amour et son affection, non seulement à son partenaire amoureux, mais aussi à ses enfants, ses amis, ses parents, etc....En espérant que cette journée soit remplie d'amour, de tendresse et de bien-être! |
|
Le carnaval de la Vie
 |
|
![]() Carnaval 2011 ! Le gouvernement met la main à la poche. 50 millions de gourdes pour financer ces festivités qui célèbrent la vie dans un contexte post-séisme et de choléra. Viv lavi ! Pour ou contre la tenue du carnaval dans un contexte post-séisme et d'épidémie de choléra ? Le débat est clos et les dates arrêtés : 6, 7 et 8 mars 2011 Les arguments favorables à la plus grande manifestation culturelle du pays sont en béton : opportunités pour l'économie, visibilité, opportunités pour les créateurs, nécessité d'aller de l'avant, de croquer la vie à pleines dents, malgré la mort et la dévastation devenues le lot d'Haïti depuis plus d'un an.
Carnaval 2011 ! Le gouvernement met la main à la poche. 50 millions de gourdes pour financer ces festivités qui célèbrent la vie dans un contexte post-séisme et de choléra. Viv lavi ! Pour ou contre la tenue du carnaval dans un contexte post-séisme et d'épidémie de choléra ? Le débat est clos et les dates arrêtés : 6, 7 et 8 mars 2011 Les arguments favorables à la plus grande manifestation culturelle du pays sont en béton : opportunités pour l'économie, visibilité, opportunités pour les créateurs, nécessité d'aller de l'avant, de croquer la vie à pleines dents, malgré la mort et la dévastation devenues le lot d'Haïti depuis plus d'un an.
Et le gouvernement, en dépit d'autres priorités: reloger des sinistrés, créer des emplois, suit la vague, concède Marie Laurence Jocelyn Lassègue. Car des dizaines de milliers de personnes gagnent les rues chaque dimanche depuis près d'un mois pour s'amuser, se défouler. « Nous avons emboîté le pas », soutient la ministre de la Culture et de la Communication, tresses mythiques, collier de cuivre égyptien,« shari » blanc recouvrant son épaule droite.
50 millions sortiront des caisses de l'Etat pour financer le carnaval. Pas assez, reconnaît Mme Lassègue qui lance des appels au secteur privé. « J'appelle le secteur privé à aider les mairies », lance-t-elle, heureuse d'avoir, avec le gouvernement et les maires, levé le voile, dissiper le flou ayant entouré la tenue du carnaval dont le thème est, à Port-au-Prince, « An n selebre lavi ».
Irascible défenseure des droits de la femme, Marie Laurence Lassègue est revenue à la charge avec ses idées antisexistes provoquant des rires en coin. « Evitez les obscénités, le corps de la femme doit être respecté, car il n'est pas une marchandise », indique-t-elle en appelant les artistes, les « videoclippers » à dire non à cette tentation "avilissante", piment pourtant pour ceux si longuement gavés par les télés de clips de américains où la nudité, la violence sont des appâts d'audimat.
La ministre de la Culture et de la Communication, annonçant qu'un comité technique composé de Stéphanie St-Louis et du musicien émérite Pierre Rigaud Chéry, informe aussi de la tenue prochaine de réunions de travail entre les acteurs impliqués dans la réalisation de l'événement : PNH, MSPP, Protection civile, mairies, artistes, opérateurs culturels.
Carnaval quand même !
Des photos prises par des enfants
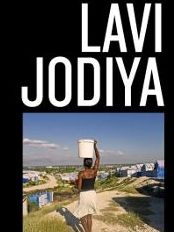 |
Le Bureau des Affaires Publiques de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique prend plaisir à inviter les amateurs de photographies, les amants de la culture et de l’art, et le public en général à prendre part au vernissage de l’exposition de photographies « Lavi Jodiya ». Les photographies sont les œuvres d’enfants démunis, illustrant leurs visions d’Haiti aujourd’hui.
Dans le cadre de ce projet, FotoKonbit, en partenariat avec la section culturelle de l’Ambassade des Etats-Unis, a organisé trois ateliers de travail dans trois zones différentes du pays au début du mois de janvier. Les participants ont appris à manier des caméras digitales sous la direction de spécialistes haïtiens et américains. Ils ont exprimé à travers leurs photos les effets de l’aide américaine dans leur communauté tout en démontrant les aspects nécessitant davantage d’assistance.
Cette initiative a permit aux jeunes de partager leur vie, de les motiver à prendre une part active au développement de leur communauté et de s’impliquer davantage pour faire connaître leurs points de vue et leurs attentes en ce qui a trait aux besoins de leur région. Des photos seront en vente au bénéfice des enfants durant l’exposition.
Cette exposition aura lieu du vendredi 28 janvier au samedi 12 février 2011, à la Galerie Monnin au # 19 de la rue Lamarre à Pétion-Ville. La Galerie est ouverte de 11:00 a.m. à 6:00 p.m. du lundi au samedi et est fermée le dimanche.
Hommages aux Victimes
 |
L’État haïtien, à travers le Ministère de la Culture, la Direction Nationale du Livre et 17 écrivains haïtiens, rend hommage aux victimes, aux survivants, aux héros, à chacun de nous au cours d’une lecture-spectacle le 11 janvier 2011, de 18 heures à 20 heures, sur la cour de la Télévision Nationale d’Haïti (TNH). Cette lecture spectacle sera diffusée en direct sur la TNH.
Des extraits de textes de 17 écrivains haïtiens et étrangers, tous présents lors du tremblement de terre, spécialement produits à l’occasion du 12 janvier seront lus par des comédiens. Ces lectures seront entrecoupées de chants interprétés par Wooly Saint-Louis Jean, Renette Désir et Nadège Dugravil.
Georges Castera, Yanick Lahens, Dany Laferrière, Franketienne, James Noël, Louis-Philippe Dalembert, Syto Cavé, Emmelie Prophète, Avin, Gary Victor, Jean-Euphèle Milcé, Lyonel Trouillot, Claude Pierre, Rodney Saint-Eloi, Evelyne Trouillot, Kettly Mars, Michel Lebris, Thomas Spear… ont repris la parole ou la plume, pour rendre hommage et parler de ce que nous avons vécu pendant l’année 2010. Les musiciens et chanteurs se sont laissés traverser par la souffrance, les questionnements, l’espoir et partagerons, avec chacun de vous, leurs notes et leurs chants.
Opinion divergente
 |
Le deuxième dimanche de Janvier est toujours consacré au lancement officiel de la période pré-carnavalesque à Jacmel et les jours gras. Cette manifestation culturelle depuis plusieurs années regroupe des gens de toutes couches sociales, venant de tout horizon, riches, pauvres, blancs, mulâtres.... Jacmel, « la ville lumière, », « ville touristique », est réputée internationalement pour son Carnaval. Selon les informations qui circulent, Jacmel, la ville du Cap et les Cayes seraient les trois grandes villes retenues pour l’organisation du carnaval en Haïti cette année.
Rappelons qu'en 2010, il n’y a pas eu de Carnaval à cause du tremblement de terre du 12 Janvier qui a frappé durement la ville de Jacmel et sa population. Les bâtiments historiques, qui ont fait la beauté touristique de Jacmel, ont été gravement endommagés par le séisme, et de nombreux artistes et artisans, qui constituent le moteur du carnaval Jacmelien, ont été victimes de la catastrophe.
La tenue du Carnaval cette année, suscite de nombreuses réactions dans la population dont les opinions sont partagées sur la tenue ou non, de cette activité culturelle. Interrogés par Haitilibre, plusieurs résidents pensent que la situation dans laquelle se trouve le pays, n’est pas propice à la fête, rappelant qu’un an après le séisme, les conditions de vie des personnes vivant sous les tentes restent inchangé, critiquant l’inaction des autorités. Certains Jacmeliens pensent que les fonds qui vont être dépensés seraient mieux utilisés pour les personnes affectées par le choléra ainsi qu’aux victimes du séisme. D’autres rappellent, que lors de la période carnavalesque, les gens consomment beaucoup d’alcool et que les excès sont souvent la cause de violences, de plus, ils mentionnent que le carnaval pourrait favoriser la propagation de l’épidémie de choléra dans un département déjà gravement affecté par la maladie.
Mais ces avis ne sont pas partagés par tous, de nombreux citoyens croient que malgré tout, le Carnaval serait un bon moment de défoulement qui pourrait aider la population à combattre le stress post-traumatique causé par le séisme, et oublier pendant cette période, la conjoncture politique déplorable dans laquelle est plongé du pays...
Le Prix de 2010
 Le Jury du Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde tient à reconnaître cette année les publications des écrivains haïtiens qui témoignent de la vivacité de ce peuple face à l’Inimaginable qui a eu lieu le 12 janvier 2010.
Le Jury du Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde tient à reconnaître cette année les publications des écrivains haïtiens qui témoignent de la vivacité de ce peuple face à l’Inimaginable qui a eu lieu le 12 janvier 2010.
« Ayiti kenbe là ! » de Rodney Saint-Eloi ainsi que « Tout bouge autour de moi » de Dany Laferrière, « Failles » de Yanick Lahens et « Create dangerously » d’Edwige Danticat sont des livres inspirés par le cataclysme qu’a connu Haïti en janvier de l’année dernière.
Ils nous parlent non seulement du séisme qui a ravagé leur pays, mais aussi des séismes politiques, sociaux et économiques qui ont eu des conséquences cauchemardesques sur Haïti.
Concours de fanaux de Noel
Fokal et American Airlines, avec le concours de Voilà, Sogecarte et Valerio Canez organisent un concours de fanaux de Noël sous le thème « Kay pa nou ». Le concours comprendra deux catégories : enfants (de 7 à 16 ans) et adultes (à partir de 16 ans). Les inscriptions, obligatoires pour toute participation au concours, se tiendront les 23, 24, 30 novembre et les 1er, 2 et 3 décembre, de 9:30 à 15:30 au local de la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL), situé au 143 de l’avenue Christophe.
Chaque participant ne pourra soumettre qu’une œuvre, représentant une des diverses formes d’architecture typiques de chez nous (maison, église, etc.). Les œuvres devront mesurer moins de 12 pouces par 12 pouces (30,5 centimètres sur 30,5 centimètres) pour les enfants. Les œuvres des adultes ne pourront dépasser 20 pouces par 20 pouces (51 centimètres sur 51 centimètres). Ces œuvres devront être réalisées en bristol et papiers de soie de couleur avec, si besoin, une base en carton.
Les œuvres devront être déposées à FOKAL du 6 au 10 décembre inclus, entre 9:30 et 15:30 de l’après-midi. Aucune soumission ne sera acceptée au-delà de cette date. Les œuvres primées seront conservées par les organisateurs afin d’être exposées dans différents lieux. Les pièces non primées seront remises aux participants le vendredi 17 décembre.
Un jury de sept personnes sélectionnera les meilleures pièces et un 1er, 2 et 3 ème prix seront remis dans chaque catégorie. Un prix d’originalité et un prix spécial pour une maison Gingerbread seront décernés en plus de ces premiers prix. Ces prix seront accompagnés de nombreuses primes : billets d’avion, four, téléviseur, téléphones portables avec cartes de recharge et cartes de cadeau offertes par les différents organisateurs et partenaires du concours.
L'amour au feminin pluriel
La littérature a longtemps été en Haïti un petit privilège, sinon la chasse gardée, des classes moyennes aisées. Aujourd’hui encore nous ne sommes pas encre à l’heure de l’existence d’un nombre important d’écrivains issus de la classe ouvrière ou de la paysannerie. Cependant les choses ont quelque peu évolué et on peut constater l’entrée en littérature de nouvelles figures ne répondant pas au profil traditionnel de « l’écrivain haïtien », tous genres confondus. Le roman en particulier a subi une évolution, le nombre de romanciers ne cessant d’augmenter. Cette évolution n’est pas sans à voir avec le succès commercial de l’opération « Livres en folie », ce rendez-vous annuel du livre qui permet aux lecteurs d’acheter moins cher et leur offre un choix varié. Grâce à la médiatisation de l’événement « Livres en folie » assure aux auteurs une grande visibilité, d’où une certaine précipitation pour faire partie du groupe d’élus dont on verra les photos, dont on lira ou écoutera les entrevues avant et après les triomphales séances de signature. Le livre n’est plus ainsi de l’ordre du mystère, affaire de quelques uns constituant un petit monde prestigieux et occulte. N’importe qui se sent aujourd’hui le droit d’écrire et de publier, comme n’importe qui se sent le droit d’acheter, de lire et d’assumer ses préférences. D’une certaine façon, et c’est là une bonne chose, la vie du livre se démocratise. Mais tout n’est pas rose. Il n’y a pas beaucoup de choses de faites en ce qui concerne l’éducation esthétique du lectorat. Il n’y a pas non plus, chez un grand nombre de nouveaux venus dans l’écriture littéraire, le souci de la qualité littéraire. Quand il y a le souci, il n’y a pas forcément le savoir-faire. Ce n’est guère la faute aux « auteurs », et il ne s’agit pas de les accuser. La cause de ce malheur tient sans doute au niveau de culture générale d’une société dominée par la précarité, acceptant tout et n’importe quoi. Nombreux sont les jeunes qui n’ont pas eu la chance de savoir distinguer un grand texte d’un roman de gare. Nombreux sont les jeunes qui entrent en écriture avec une culture littéraire s’arrêtant au XVIIe siècle. Nombreux sont ceux qui n’ont même pas les rudiments de cette culture classique, n’ayant lu en tout et pour tout que la collection Harlequin et d’autres du même genre. Voilà, médiatisation aidant, amateurs de fast food promus au rang de chef cuisinier. Dans cette nouvelle réalité et bénéficiant d’une grande visibilité, une liste qui augmente d’année en année de jeunes romancières produisant des romans qu’on pourrait dire d’amour, des histoires à l’eau de rose avec un fond de mélodrame : histoire d’amour contrariée entre une jeune femme et un homme plus âgé, entre une amante passionnée e dans l’expectative et un homme marié ; malheurs d’une jeune femme d’origine modeste et / ou de tempérament crédule, abusée par un ou plusieurs hommes, jusqu’au jour où elle trouve le véritable amour. Thématique quelque peu éculée, sans surprise ni imagination sur le mode des séries télévisées ou radiophoniques dont la recette est connue : psychologie de bas étage, division des personnages entre les purs et les méchants, clichés. Mais on peut faire de la littérature avec n’importe quel thème. Il suffit d’une langue… littéraire, d’un engagement esthétique et humain. Il est dommage que cet élan, ce vouloir écrire qui anime aujourd’hui ces jeunes « romancières » ne soit pas toujours enrichi par la patience nécessaire à l’excellence et par une plus grande culture littéraire. Dommage pour elles. Dommage pour le lecteur.
Un devoir patriotique
Nos concitoyens haïtiens ont pris l’habitude d’utiliser le mot créole en lieu et place du mot haïtien sans prêter attention au tort que cela peut causer à la pérennité de notre existence de peuple. Le mot créole a été inventé par les colonisateurs pour parler des attributions coloniales. Tout ce qui est créole appartient à une colonie.
Ainsi, on peut donner trois sens au mot créole. Sens 1 : Blanc d’origine européenne né dans une colonie. Sens 2 : Langue parlée dans une colonie. À ce chapitre, les chercheurs regroupent quatre types de créoles : 1) Le créole à base lexicale anglaise que l’on retrouve dans les colonies ou anciennes colonies britanniques. 2) Le créole à base lexicale portugaise que l’on rencontre dans les colonies ou anciennes colonies portugaises. 3) Le créole à base lexicale espagnole que l’on rencontre dans les colonies ou anciennes colonies espagnoles. 4) Le créole à base lexicale essentiellement gréco-latine que l’on retrouve dans les colonies ou anciennes colonies françaises telles que la Martinique, la Guadeloupe, etc. Sens 3 du mot créole: Langue en formation, langue qui n’a pas d’alphabet officiel.
Ces définitions correspondent surtout au statut de la Guadeloupe et de la Martinique pour ne citer que ces deux territoires français. Dans le cas d’Haïti, elles ne servent qu’à cacher à la face du monde son identité nationale et son statut de République.
C’est pour cela qu’il convient de faire immédiatement le deuil du mot créole dans nos communications haïtiennes. Car le créole est utilisé consciemment ou inconsciemment pour assassiner haïtien. Il sert à masquer le mot haïtien qui évoque l’existence de notre peuple et ses créations.
Dorénavant, quand il s’agit d’Haïti, ne dites plus fusil créole, langue créole, restaurant créole, conte créole, littérature créole, communication créole, femme créole, créolophone, créolophonie, créoliste, etc. Dites plutôt, fusil haïtien, langue haïtienne, restaurant haïtien, conte haïtien, littérature haïtienne, communication haïtienne, femme haïtienne, haïtianophone, haïtianophonie, haïtianiste, etc.
Le mot créole n’évoque pas l’origine nationale de l’objet dont on parle. À chaque fois, on fait l’usage du mot créole en lieu et place de l’haïtien, on contribue volontairement ou involontairement à la disparition du mot haïtien et ses attributions.
D’après Alain Rey, linguiste et auteur du Petit Robert, toutes les langues passent une étape appelée créole. Mais, lorsque le pays où une langue est parlée par une majorité de citoyens et de citoyennes décide d’adopter un alphabet officiel pour fixer le statut et l’appartenance nationale de cette langue, cette dernière change d’appellation CRÉOLE pour porter le nom de la nationalité du pays qui lui a donné l’alphabet officiel.
C’est pour cela, on parle l’italien en Italie, le français en France, l’allemand en Allemagne, l’haïtien en Haïti, etc. La langue parlée en Haïti, s’appelle l’Haïtien depuis le 28 septembre 1979, date à laquelle le Parlement de la République adopta l’alphabet officiel de la langue haïtienne dans le cadre de la réforme de l’école fondamentale qui a été mise en place par le Décret-loi du 30 mars 1982.
Ce Décret-loi stipule dans article 29 que l’haïtien est la langue enseignée et langue d’enseignement tout au long de l’école fondamentale. L’Article 5 de la Constitution de 1987, signale que l’haïtien est la seule langue qui unit tous les habitants d’Haïti. L’haïtien et le français sont deux langues officielles de la République d’Haïti.
Curieusement, dans le Décret-loi de 1982 et dans l’article 5 de la Constitution de 1987, c’est le mot créole que l’on a utilisé à la place de l’haïtien pour la simple et bonne raison suivante. Les législateurs et les constitutionnalistes haïtiens n’avaient pas fait appel aux spécialistes en aménagement de politique linguistique qui traitent la question du statut des langues.
Toutefois, chaque citoyen, chaque citoyenne d’Haïti doit se faire un devoir patriotique en apportant cette correction dans ses conversations et à l’intérieur de tous les textes de loi du pays, car le mot créole sert à assassiner l’haïtien qui rappelle l’existence, les créations et le statut réel de notre peuple.
Prophète Joseph
M.éd., linguiste et professeur.
josephprof@hotmail.com
Conservons le mot "Creole"
Dans ce texte intitulé « Faisons immédiatement le deuil du mot créole un devoir patriotique » qui est d’une pauvreté argumentative désespérante, Prophète Joseph (PJ) reprend les thèmes les plus éculés des adversaires des langues créoles et du créole haïtien. Il y a eu dans le passé un certain nombre de personnes qui se sont attachées à rejeter le terme « créole » au profit de « l’haïtien ». Mais aucune n’est tombée dans la démagogie et le « n’importe quoi » de PJ.
D’après PJ, « le mot créole a été inventé par les colonisateurs pour parler des attributions coloniales. Tout ce qui est créole appartient à une colonie. » Si le mot créole a été inventé par les colonisateurs, (tous les linguistes spécialisés en langues créoles admettent aujourd’hui que le mot vient de l’espagnol « criollo » et a été francisé dans la seconde moitié du 17ème siècle) les langues créoles existent bel et bien.
Elles ont pris naissance dans plusieurs iles des Caraïbes et de l’Océan Indien au cours des 17ème et 18ème siècles et se sont développées dans des sociétés coloniales de plantation. L’émergence des langues créoles relève d’un phénomène bien connu en linguistique appelé contact de langues.
La majorité des linguistes qui ont étudié les langues créoles sont tous d’accord sur le fait que la diversité des langues en contact rendait extrêmement difficile l’acquisition de l’une de ces langues en tant que lingua franca disponible à toute la population.
A Saint-Domingue, les locuteurs des langues de la famille des langues du Niger-Congo qui ne sont pas mutuellement intelligibles étaient placés en contact avec des locuteurs de dialectes français car il n’y avait pas encore une variété standardisée du français. C’est de cette rencontre, de ce contact que le créole haïtien a pris naissance.
A ce niveau-là, le mot importe peu. La réalité, c’est-à-dire l’existence d’un système linguistique original composé de sons (phonèmes) arrangés d’une manière particulière (phonologie) pour former des mots (morphologie) et constituer une grammaire (syntaxe) qui communique un sens (sémantique) est beaucoup plus fondamentale. Le créole haïtien est ce système. Il est différent d’autres systèmes linguistiques qui ont nom « le français », « l’anglais », « le russe », « le chinois », etc.
Des trois sens du mot « créole » que PJ a relevés, seuls les sens 1 et 2 sont exacts car ils sont basés sur des réalités historiques. Le troisième sens est complètement fabriqué par PJ et est indigne de quelqu’un qui se dit linguiste. Voici ce que PJ écrit : « Sens 3 du mot créole : Langue en formation, langue qui n’a pas d’alphabet officiel. »
Depuis quand le critère d’alphabet officiel sert-il à définir le mot « créole ». En fait, qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? On est ici en plein « n’importe quoi ». Et cette personne se dit linguiste !
Tout le texte de PJ tourne autour de ce genre d’affirmation gratuite, tout à fait fantaisiste et sans queue ni tête. J’en cite une au hasard : « Le créole est utilisé consciemment ou inconsciemment pour assassiner l’haïtien. Il sert à masquer le mot haïtien qui évoque l’existence de notre peuple et ses créations. » Ceci est un autre exemple de faux nationalisme, cette maladie infantile des démagogues haïtiens.
PJ dit que « d’après Alain Rey, linguiste et auteur du Petit Robert, toutes les langues passent une étape appelée créole. » Tout le monde connaît Alain Rey, excellent lexicographe et maître d’œuvre du dictionnaire Robert, mais il faut prendre avec des pincettes cette affirmation que lui attribue PJ. Il est possible que Alain Rey fait référence à une thèse bien connue dans le monde des linguistes selon laquelle un certain nombre de langues occidentales prestigieuses, comme le français et l’anglais, seraient des « créoles qui ont réussi ».
Selon cette thèse, le français et l’anglais ont été à leurs débuts des « créoles » (le français, un créole latin ; l’anglais, un créole germanique saupoudré de latin). Ces « créoles » ont réussi parce que grâce à une combinaison de forces historiques et économiques, ils ont pu se détacher de leurs ancêtres linguistiques (le latin et les langues germaniques) et devenir des « puissances » linguistiques autonomes. Mais je doute que Alain Rey pense qu’il existe une entité appelée créole considérée comme une étape obligée pour toutes les langues.
Certains Haïtiens pensent que l’utilisation du terme « haïtien » pour remplacer celui de « créole » pourra « effacer » la « honte » et les connotations d’infériorité qui sont selon eux attachées au terme créole et restent encore vivaces non seulement dans l’esprit des anciens colonisateurs mais aussi chez certains anciens colonisés. Rien n’est plus faux.
L’étude des attitudes linguistiques chez les locuteurs nous apprend que les facteurs qui président à la construction des représentations linguistiques relèvent de phénomènes extralinguistiques. Quoiqu’il en soit, il existe en Haïti deux langues réparties inégalement dans la population.
L’une qui est parlée par une petite minorité de locuteurs haïtiens (moins de 5%, disent certains chercheurs) et qui est le français haïtien, c’est-à-dire une variété de français qui possède des traits phonologiques, lexicaux et syntaxiques particuliers par rapport à la variété de français parlée en France et dans d’autres pays francophones ; l’autre qui est parlée par tous les locuteurs nés et élevés en Haïti, dont ceux qui connaissent aussi le français, qui est le créole haïtien, c’est-à-dire une variété de créole à base lexicale française parlée dans la Caraïbe francophone et dans l’Océan Indien.
C’est sous ce nom de créole (kreyòl) que la population haïtienne a toujours appelé sa langue maternelle. Il n’y a pas de raison valable et légitime pour changer ce nom.
De l'importance de la question des langues en Haiti
Nous avons une vague intuition que les Haïtiens en général (toutes classes sociales confondues) se fichent de la question des langues et particulièrement de la question de la langue créole en Haïti. Les débats incessants et chargés d'émotion qui surgissent régulièrement à propos de l'opposition traditionnelle français vs créole peuvent faire illusion mais je les considère comme l'arbre qui cache la forêt.
Pour les locuteurs haïtiens en général, la langue créole demeure le cadet de leurs soucis. Ils se contentent de s'en servir pour régler leurs innombrables taches quotidiennes mais ne se privent pas de la vilipender quand l'occasion se présente. Certaines personnes pourraient me rétorquer qu'il en est ainsi chez la majorité des locuteurs du monde, qui prennent leur langue maternelle pour un fait acquis et parlent comme ils marchent ou comme ils respirent, par exemple. C'est vrai, sauf que la majorité des locuteurs du monde ne vilipendent pas à tout bout de champ la langue qu'ils utilisent quotidiennement.
Pour d'autres locuteurs, vaguement conscients de l'importance de leur langue native, on entend parfois des réflexions du genre « Ala yon bèl lang se kreyòl ! Mwen fè sa m vle ak li » (Quelle belle langue, le créole ! J'en fais ce que je veux) sans se rendre compte qu'une telle position est loin d'être absolue, que tout le monde peut dire autant de sa langue maternelle.
S'il y avait un doute sur l'importance de la question linguistique en Haïti, les préparatifs devant mener aux élections présidentielles de novembre 2010 ont apporté un démenti formel à une telle opinion. Dans cet ordre d'idées, tout a commencé avec l'entrée en scène de M. Wyclef Jean, le célèbre chanteur hip hop, qui voulait se présenter aux élections présidentielles de novembre. (J'écris ces lignes vingt-quatre heures après que le Conseil Électoral Provisoire [CEP] ait décidé que M. Jean ainsi qu'une quinzaine d'autres aspirants candidats ne pourront pas se présenter aux élections de novembre).
L'entrée en scène de Wyclef Jean a révélé les contradictions, les subtilités et l'importance extraordinaire de la question des langues en Haïti. Jamais peut-être la langue n'a été perçue comme un enjeu social aussi vigoureux en Haïti et les forums de discussion consacrés à Haïti l'ont montré clairement à travers les diverses interventions des intervenants. Sur l'un de ces forums, un internaute s'est moqué de la compétence linguistique de M. Jean et a déclaré qu'il « ne parle aucune langue ».
Un autre a qualifié sa capacité linguistique en anglais de « Street English ». Certains ont tourné en dérision l'accent anglophone qui superpose son expression créole. (Rappelons que Jean a laissé Haïti pour les États-unis à l'âge de neuf ans). Quant au français, son immersion totale dans la culture et la langue américaines dès son arrivée aux États-unis ne lui a laissé aucune opportunité pour apprendre le français ou continuer l'apprentissage du français. Le linguiste que je suis condamne bien sûr ces jugements de valeur sur la compétence linguistique de M. Jean mais ils sont révélateurs de l'importance de la question des langues dans le corps social haïtien.
Or, dans le contexte politique (haïtien ou n'importe quel autre), l'éloquence reste un atout particulièrement apprécié. En Haïti, au cours de ces cinquante dernières années, les deux hommes politiques qui ont le plus marqué les foules populaires demeurent Daniel Fignolé et Jean-Bertrand Aristide. Ici, je ne me réfère nullement au contenu de leurs discours mais d'abord et surtout à leur verve, leur bagout, le don de la parole qu'ils possédaient et grâce auquel ils arrivaient à manipuler les foules.
On a parlé de « woulo konpresè » (rouleau compresseur) dans le cas de Daniel Fignolé et de ses aptitudes à électriser les foules de ses partisans ; quant à Jean-Bertrand Aristide, la dénomination même de son parti politique, Lavalas, indique ce qu'il attendait de ses supporteurs. Dans ces conditions, ne pas posséder la langue légitime équivaut à signer son arrêt de mort politique. Dans la mesure où le créole a pénétré au cours de ces vingt-cinq dernières années la majeure partie des lieux publics ou officiels auparavant strictement réservés au français, on peut penser qu'il constituera un enjeu formidable durant cette campagne électorale présidentielle à venir. En particulier, je suivrai attentivement dans quelle mesure l'éloquence ou l'absence d'éloquence de tel ou tel candidat le propulsera au-devant de la scène politique ou diminuera ses chances de se faire écouter.
Les interactions qui se déroulent entre locuteurs ont ceci de particulier qu'elles révèlent la structure sociale qui leur sert de cadre. L'observation des échanges de parole en Haïti, qu'ils soient conduits en français ou en créole, dévoilera tout un ensemble de facteurs sous-tendant la conversation tels que l'âge, le sexe, la profession, l'origine sociale, le degré de scolarisation des interlocuteurs. Cependant, Pierre Bourdieu (Ce que parler veut dire, 1982 : 42) nous met en garde contre la tendance à privilégier « les constantes linguistiquement pertinentes au détriment des variations sociologiquement significatives pour construire cet artefact qu'est la langue « commune ». Ce faisant, dit Bourdieu, « on fait comme si la capacité de parler, qui est à peu près universellement répandue, était identifiable à la manière socialement conditionnée de réaliser cette capacité naturelle, qui présente autant de variétés qu'il y a de conditions sociales d'acquisition.
Dans le cas d'Haïti, il existe pourtant un paradoxe qui se traduit par la quasi uniformité chez les locuteurs haïtiens du français parlé qui ne possède qu'un seul registre en Haïti. On explique ceci par les conditions sociales d'acquisition du français qui se ramènent à part quelques rares exceptions à l'apprentissage scolaire. En revanche, les locuteurs haïtiens s'exprimant en créole (toute la population haïtienne) réalisent « autant de variétés qu'il y a de conditions sociales d'acquisition ». Une confirmation de plus de la légitimité du créole haïtien au sein du corps social haïtien.
Traditionnellement, la question des langues en Haïti se ramène à l'opposition français-créole et les comportements langagiers des locuteurs découlant des contacts réguliers et des interférences réciproques entre le créole et sa langue lexificatrice de base, le français.
Cependant, par suite du déplacement du pôle d'intérêt des Haïtiens en général vers les États-unis et sa culture, une troisième langue, l'anglais, est venue se placer sur l'échiquier linguistique. Quelle est ou quelle sera sa place à l'intérieur de la question des langues en Haïti ? Il faut se garder des réponses faciles comme certains de mes compatriotes ont tendance à le faire et privilégier des recherches longues et sérieuses avant d'apporter des tentatives de réponses à ces questions.



