700 haitiens en 5 jours....
 |
La Direction Générale de l'immigration a intensifiée cette année, le rapatriement des haïtiens sans papiers. Pour les 5 premier jours de l’année 2011, plus de 700 personnes en situation irrégulière, ont été retourné en Haïti. Les haïtiens ont été arrêtés lors de patrouilles sur les grands axes routiers, les « checkpoints » ou dans les rues de Montecristi, Valverde, Santiago, Sabaneta, Barahona, Dajabon... Le général Gil Ramirez a déclaré que les opérations sont effectuées avec les inspecteurs de la Direction générale de l'immigration et du personnel du Ministère de la Santé.
Le Vice Amiral Sigfrido Pared Pérez, Directeur Générale de l'immigration a déclaré qu’aucune entrée illégale sur le territoire dominicain ne sera tolérée.
À Santiago, un haïtien, Silié Ramon 19 ans est décédé après avoir tenté de s’enfuir d’un camion qui transportait 30 de nos compatriotes pour reconduite à la frontière. D’après des témoignages, Silié Ramon à sauté du camion est s’est fait renverser par un camion qui suivait le transport, le jeune homme a subit de graves traumatismes aux bras, au jambes et à la tête et n’a pu être sauvé. L’incident s’est produit à Guatapanal entre Santiago et Mao.
Un dominicain, Charlis Luna Generoso, 23 ans, membre des forces spéciales de la sécurité des frontières (CESFRONT) a été arrêté, après avoir été surpris en train de recevoir de l’argent d’un haïtien pour laisser passer des illégaux sans papier.
D’autre part, Taiwan à fait un don de 500,000 dollars aux services d’immigrations dans le cadre d'un accord bilatéral. Cet argent a permis d’acquérir 16 véhicules, 16 lecteurs de passeports biométriques et des équipements pour détecter les faux documents. De plus, quatre postes de contrôle vont être construit dans la zone frontalière de migration.
Augmentations des troupes...
 |
Le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine et Président du Conseil de sécurité pour le mois de janvier, M. Ivan Barbaliæ, a présenté, mardi 4 janvier 2011, le programme de travail du Conseil. Il a d’emblée souligné que si ce programme était à priori « léger », les membres du Conseil resteront prêts à agir en ce qui concerne « le Soudan, la Côte d’Ivoire et Haïti ».
M. Barbaliæ a résumé la situation politique difficile en Haïti, suite à la publication des résultats préliminaires des élections du 28 novembre 2010, qui ont mené à des accusations de fraudes, la contestation des résultats et des manifestations violentes à travers le pays. Il a rappelé, que le second tour des élections en Haïti prévu initialement le 16 janvier 2011, sera sans doute reporté en raison du processus de vérification en cours et qu’il était important de regarder la situation sur le terrain dans une perspective politique.
À cette fin, le Représentant permanent, a indiqué que le 20 janvier, le Conseil de sécurité entendrait un exposé sur les développements politiques dans le contexte post électoral sur la base duquel il pourrait être amené à envisager une augmentation des troupes de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH). « Il est du devoir du Conseil d’assurer le bon fonctionnement de la Mission, et ce, dans l’intérêt de tous les Haïtiens », a-t-il dit.
Assassibat, 2 morts
 |
Le mardi 4 janvier 2011, dans la soirée, des inconnus non identifiés, ont ouvert le feu sur un véhicule de l'Autorité Portuaire National (APN), tuant sur le coup ses deux occupants. Un agent de la Police National d’Haïti (PNH) en uniforme, Oxène Elvitus et son chauffeur Louis Wilzer. Le meurtre s’est déroulé en face de l'école frère Roc au niveau de Martissant 17, quartier situé au Sud de la capitale. Les meurtriers se sont enfuit en emportant les armes qui étaient à bord du véhicule des victimes.
Gary Desrosiers, le porte-parole adjoint de la PNH à confirmé la mort des deux hommes, l'ouverture d'une enquête et a invité la population à collaborer avec la police.
Vulnerabilite des enfants face au Cholera....
 |
Les caractéristiques physiologiques des plus jeunes les rendent fragiles face à la maladie. Sergio Cabral, Pédiatre au Centre de Traitement du Choléra (CTC) de Sarthe à Port-au-Prince, nous explique les spécificités de la prise en charge du choléra chez les enfants.
Pourquoi porter une attention particulière aux enfants ?
Les enfants sont en cours de croissance. Parce que leur superficie corporelle est moins importante, le vibrion du choléra occupe l'intestin plus rapidement et la maladie se propage plus vite. En comparaison, une même quantité de vibrion affectera beaucoup plus un enfant qu'un adulte. Par ailleurs, leur système immunitaire n'est pas complètement développé. Ils sont donc plus vulnérables face au choléra et auront plus de difficultés à combattre l'infection.
De plus, les enfants ne maitrisent pas les mesures d'hygiène, ce qui peut favoriser leur contamination. Ce peut être un facteur de vulnérabilité supplémentaire mais ce n'est pas une vérité absolue car le comportement des adultes est sensiblement similaire.
Proposez-vous une prise en charge spécifique ?
Le traitement est identique à celui des adultes. Réhydratation orale pour les cas simple et par voie intraveineuse pour les cas sévères. La particularité essentielle réside dans le calcul de la dose et du flux de solution à administrer selon l'âge, le statut nutritionnel et d'éventuelles pathologies associées. Lorsque les pertes en liquides sont extrêmement abondantes, la réhydratation est complétée par un traitement antibiotique, administré selon le poids, pour les enfants de plus d'un an.
Le personnel doit être expérimenté en pédiatrie car la déshydratation entraine un assèchement des veines rendant difficile la pose d'une perfusion chez un enfant. Parfois, piquer dans le bras n'est pas possible, alors nous essayons dans la main, la jambe puis la tête. En dernier recours, nous pratiquons une injection intra-osseuse. Une opération délicate mais qui doit être réalisée rapidement car pour un enfant qui présente une déshydratation sévère, le facteur temps est déterminant.
Parce qu'ils demandent une attention particulière et du personnel soignant adapté, les enfants sont pris en charge dans un espace spécifique. Sur une capacité d'hospitalisation de 336 lits (14 tentes de 24 lits) dans notre centre de traitement du choléra de Sarthe, 72 lits (21.4%) sont dédiés à la pédiatrie. Un chiffre qui varie car nous adaptons continuellement notre réponse à l'évolution de l'épidémie.
Quelles sont les difficultés spécifiques liées aux enfants ?
Il y a d'abord la problématique des pathologies associées : pneumonie, asthme qui compliquent le traitement et vulnérabilise d'autant plus l'enfant. Nous traitons en priorité le choléra, qui est l'urgence vitale, puis l'autre pathologie avec un traitement adapté. Pour le cas particulier de la malnutrition, dont le traitement n'est pas compatible avec la prise en charge du choléra, nous transférons les enfants guéris du choléra dans des structures MSF spécialisées en nutrition.
Nous sommes également confrontés à des cas d'enfants sans autorité parentale. Il y a des enfants qui arrivent seuls, soit parce que leur(s) parent(s) sont malades soit parce qu'il y a d'autres enfants à charge à la maison. Parfois, l'enfant est abandonné car le choléra fait encore peur. Une fois guéris, l'assistance sociale les prend en charge. Mais avec les messages d'information et de sensibilisation, cela devient plus rare.
Dernier bilan du choléra : Depuis que l’épidémie de choléra a fait son apparition dans le pays (19 octobre 2010), 157,321 personnes ont été infectées et traitées, 87,639 personnes ont dû être hospitalisées et 3,401 personnes sont décédées. Selon le dernier bilan du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), daté du 29 décembre 2010.
Projet de developpement durable.....
 |
Un vaste programme de reconstruction intégrant le développement durable a été lancé mardi dans le Sud-Ouest d'Haïti, à Port-Salut, par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE).
En partenariat avec plusieurs partenaires, dont les gouvernements haïtiens et norvégien, des organisations non gouvernementales locales et internationales et l'Institut de la Terre de l'Université Columbia, l'Initiative pour la Côte Sud (ICS) vise à la remise en état et au développement durable d'une zone de terres fortement dégradées de 780 km² et d'une zone marine d'environ 500 km², sur les vingt prochaines années.
Dix communes, soit près de 205,000 personnes, vont bénéficier directement du programme, qui prévoit le reboisement, la lutte contre l'érosion, la gestion de la pêche, la réhabilitation des mangroves, le développement du tourisme et l'appui à la création de petites entreprises locales. L'ICS doit également permettre d'améliorer l'accès à l'eau, l'assainissement, la santé et l'éducation.
« Le rétablissement des services environnementaux dans cette région est une étape clé pour le secteur d'activités alliant développement réel, développement durable et transition vers une économie verte », a indiqué Achim Steiner, Directeur du PNUE lors du lancement du projet.
« Après la forêt de Mau au Kenya et le lac Faguibine au Mali, c'est maintenant Haïti. Le PNUE et ses partenaires sont déterminés à montrer que la restauration et la mise en valeur des écosystèmes sont des catalyseurs efficaces pour lutter contre la pauvreté et réduire la vulnérabilité aux catastrophes naturelles », a-t-il ajouté.
Le lancement de l'ICS, rendu possible par le financement initial de 14 millions de dollars assuré par le gouvernement de la Norvège et l'ONG Catholic Relief Services, est une étape importante pour le PNUE, qui a conçu et développé ce programme avec le gouvernement haïtien et ses partenaires dès le début de 2009, soit un an avant le tremblement de terre du 12 janvier 2010.
« Le destin et le développement d'Haïti sont entre les mains du gouvernement et du peuple d'Haïti, le rôle de la Norvège et des partenaires internationaux est tout simplement de les soutenir », a estimé le Ministre norvégien de l'environnement et du développement international, Erik Solheim, qui a assisté au lancement du projet à Port-Salut.
« Il est clair que toutes les initiatives de développement dans le pays ont besoin d'intégrées la gestion durable des ressources naturelles. Pour le Sud d'Haïti, nous voyons des opportunités dans le tourisme, l'énergie propre et l'agriculture durable et nous sommes très heureux d'appuyer les investissements dans ces secteurs d'activités », a-t-il ajouté.
Avant le tremblement de terre dévastateur de janvier 2010, Haïti était déjà l'un des pays les plus pauvres, les moins stables et à l'environnement le plus dégradé de l'hémisphère Nord. L'extrême pauvreté, l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité aux catastrophes étant étroitement liés aux questions environnementales telles que la déforestation, l'érosion des sols et des terres, ou la dégradation du milieu marin.
L'Initiative pour la Côte Sud ambitionne donc d'inverser radicalement la tendance sur les deux prochaines décennies, avec cette nouvelle approche du développement, qui met l'accent sur la coordination de l'aide, l'appropriation nationale des ressources et le renforcement des capacités du gouvernement pour éradiquer les causes profondes de la pauvreté, de la dégradation de l'environnement et de la vulnérabilité aux catastrophes naturelles.
Pourquoi pas un rapport?
ONG
|
|
|
Haïti: Un rapport publié sur les activités des Organisations non gouvernementales (ONG) en Haïti par l'ONG américaine Disaster Accountability Project fait état d'un manque de transparence dans leur mode de gestion. Très peu d'informations, a noté le rapport, sont disponibles sur la manière dont les ONG ont dépensé les millions de dollars collectés aux Etats-Unis suite au passage du meurtrier séisme dans le pays. Seules 38 des 196 ONG considérées dans le cadre dudit rapport ont rempli le questionnaire qui leur a été soumis.
Sur les 38 ONG qui ont répondu, 35 disent fournir des informations régulières sur leurs activités de terrain. « Nous avons cependant constaté que seules 8 des 196 organisations donnent effectivement des informations régulières sur leur site », a indiqué Ben Smillowitz, directeur exécutif de Disaster Accountability Project.
Les auteurs du rapport n'ont pas dénombré le volume d'ONG américaines travaillant dans le pays. De quoi compliquer leurs démarches pour savoir la quantité d'argent collecté aux Etats-Unis au profit des victimes du séisme. Cependant, les 38 ONG ayant rempli le questionnaire soumis ont collecté à elles seules 1.4 milliard de dollars. La majorité des 38 ONG n'ont répondu à la question sur les intérêts que la somme collectée leur rapporte en la plaçant en banque. Seules cinq ont accepté de répondre à cette question. Les intérêts gagnés sur l'argent reçu par ces cinq organisations s'élève à 1.8 million de dollars.
Des 1.4 milliard de dollars collectés par les 38 ONG ayant rempli le questionnaire presque la moitié n'est pas encore engagée. Selon le rapport, de janvier à décembre, environ 730 millions de dollars de cette somme, soit 52%, ont été dépensés dans des actions en faveur des victimes du séisme. La plupart des ONG considérées n'ont pas répondu aux questions posées. Une situation qui laisse perplexe Ben Smillowitz. « Une telle situation va porter les gens à réfléchir avant de participer aux collectes de fonds suite à une catastrophe. Un meilleur partage d'informations peut augmenter la crédibilité des ONG aux yeux des donateurs », a dit au Nouvelliste le directeur de Disaster Accountability Project.
Un motard tue un Policier

278 Haitiens en Afrique
 |
Après le Sénégal (163), le Bénin (110) le Rwanda a accueillit hier sur son territoire, 5 étudiants haïtiens, 3 garçons et 2 filles [Nicolenstia Bateau, Wendy Bianca Jean-Ulysse, Ambroise Jean-Louis, Jean-Max Marcellus, et Estivens Fleury]. Ces 5 boursiers, sélectionnés par le Gouvernement haïtien, seront entièrement pris en charge par le gouvernement Rwandais, et rejoindront l'Université Nationale du Rwanda (UNR) pour suivre des études de premier cycle, en sciences sociales et administration des affaires, dès la rentrée universitaire, le 10 Janvier 2011.
Ce partenariat de formation est le premier du genre entre les gouvernements du Rwanda et Haïti et fait suite aux entretiens entre le président Kagame et son homologue René Préval en Septembre 2010. Le Ministère des Affaires étrangères rwandais a précisé que ces bourses s’inscrivent « dans le cadre de la coopération Sud-Sud pour le développement [...] ce programme de bourses est une initiative conjointe des gouvernements du Rwanda et d’Haïti, et la Commission bilatérale Haïti-Rwanda [crée en 2010], et fait partie d'un certain nombre d’autres programmes entre les deux pays »
« Le Rwanda a été un ami extraordinaire en Haïti au moment de la tragédie, et nous sommes reconnaissants pour cette offre généreuse de soutien » à fait savoir Didi Bertrand Farmer, le coordonnateur de la Commission Haïti-Rwanda « Le Rwanda a une compréhension unique du rôle de la jeunesse dans le processus de reconstruction » a-t-il ajouté.
Rappelons que le Rwanda, a fait un don de près de 100 000 dollars pour les efforts de reconstruction en Haïti et que plus de 200 rwandais participent dans la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (Minustah).
Opinion divergente
 |
Le deuxième dimanche de Janvier est toujours consacré au lancement officiel de la période pré-carnavalesque à Jacmel et les jours gras. Cette manifestation culturelle depuis plusieurs années regroupe des gens de toutes couches sociales, venant de tout horizon, riches, pauvres, blancs, mulâtres.... Jacmel, « la ville lumière, », « ville touristique », est réputée internationalement pour son Carnaval. Selon les informations qui circulent, Jacmel, la ville du Cap et les Cayes seraient les trois grandes villes retenues pour l’organisation du carnaval en Haïti cette année.
Rappelons qu'en 2010, il n’y a pas eu de Carnaval à cause du tremblement de terre du 12 Janvier qui a frappé durement la ville de Jacmel et sa population. Les bâtiments historiques, qui ont fait la beauté touristique de Jacmel, ont été gravement endommagés par le séisme, et de nombreux artistes et artisans, qui constituent le moteur du carnaval Jacmelien, ont été victimes de la catastrophe.
La tenue du Carnaval cette année, suscite de nombreuses réactions dans la population dont les opinions sont partagées sur la tenue ou non, de cette activité culturelle. Interrogés par Haitilibre, plusieurs résidents pensent que la situation dans laquelle se trouve le pays, n’est pas propice à la fête, rappelant qu’un an après le séisme, les conditions de vie des personnes vivant sous les tentes restent inchangé, critiquant l’inaction des autorités. Certains Jacmeliens pensent que les fonds qui vont être dépensés seraient mieux utilisés pour les personnes affectées par le choléra ainsi qu’aux victimes du séisme. D’autres rappellent, que lors de la période carnavalesque, les gens consomment beaucoup d’alcool et que les excès sont souvent la cause de violences, de plus, ils mentionnent que le carnaval pourrait favoriser la propagation de l’épidémie de choléra dans un département déjà gravement affecté par la maladie.
Mais ces avis ne sont pas partagés par tous, de nombreux citoyens croient que malgré tout, le Carnaval serait un bon moment de défoulement qui pourrait aider la population à combattre le stress post-traumatique causé par le séisme, et oublier pendant cette période, la conjoncture politique déplorable dans laquelle est plongé du pays...
Le Prix de 2010
 Le Jury du Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde tient à reconnaître cette année les publications des écrivains haïtiens qui témoignent de la vivacité de ce peuple face à l’Inimaginable qui a eu lieu le 12 janvier 2010.
Le Jury du Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde tient à reconnaître cette année les publications des écrivains haïtiens qui témoignent de la vivacité de ce peuple face à l’Inimaginable qui a eu lieu le 12 janvier 2010.
« Ayiti kenbe là ! » de Rodney Saint-Eloi ainsi que « Tout bouge autour de moi » de Dany Laferrière, « Failles » de Yanick Lahens et « Create dangerously » d’Edwige Danticat sont des livres inspirés par le cataclysme qu’a connu Haïti en janvier de l’année dernière.
Ils nous parlent non seulement du séisme qui a ravagé leur pays, mais aussi des séismes politiques, sociaux et économiques qui ont eu des conséquences cauchemardesques sur Haïti.
Pas de 2e Tour avant Fevrier
 |
Pierre-Louis Opont, Directeur Général du Conseil Électoral Provisoire (CEP) a déclaré que le CEP ne sera pas en mesure de tenir un deuxième tour de l'élection présidentielle contestée avant février. « Il est matériellement impossible d'organiser le second tour le 16 Janvier 2011 [...] à partir de la date de la publication des résultats définitifs du premier tour, nous aurons besoin d'au moins un mois pour tenir le second tour ».
Impossible d’avoir plus de précision sur une date, puisque le CEP semble ignorer quand les travaux de vérifications et de recomptage du premier tour, par les experts de l'Organisation des États américains (OEA) s’achèveront. Un calendrier ne pourra être envisagé qu’après la remise du rapport de l’OEA et la publication des résultats définitifs.
Rappelons que les experts de l’OEA ont commencé leur travail, jeudi 30 décembre 2010 et qu’aucune information ne filtre, comme l’avait mentionné Albert Ramdin, Secrétaire Général adjoint de l’OEA « aucune déclaration publique ne sera faite au cours du processus qui se déroulera à huis-clos et qui s’achèvera par la publication d’un rapport, probablement la semaine prochaine... »
Il est fort probable que cette déclaration, faite avant même le début de la Mission, avait pour unique objectif, de calmer les esprits, en laissant entendre que cela prendrait moins d’une semaine. Il nous faut donc attendre que ces experts achèvent leurs tâches et espérer qu’après la publication des résultats définitifs, Haïti ne retombera pas dans une nouvelle période de trouble, qui ne pourrait qu’ajouter des délais supplémentaires.
Brasil et Cuba veulent faire plus pour Haiti
 |
Lors d’une réunion, le 2 janvier dernier, entre le Brésil et Cuba, au Palais National (Palácio do Planalto) à Brasilla, Haïti a été à l'ordre du jour entre la nouvelle Présidente brésilienne Dilma Rousseff et le premier Vice-président cubain José Ramón Machado.
Au cours de cette réunion, les deux pays ont décidé d'augmenter l'aide pour Haïti, qui lutte contre une terrible épidémie de choléra. Le Brésil en avril dernier s'est déjà engagé à financer un programme de 80 millions de dollars en vertu d'un accord trilatéral Brésil-Cuba-Haïti. Ce programme comprend la rénovation et la reconstruction des hôpitaux, la construction de dispensaires et autres centres de soins de santé de base, l'établissement d'un centre d'épidémiologie nationale, la fourniture d'ambulances, et des campagnes de vaccination et de sensibilisation. Rappelons que Cuba est aussi à la tête d'un programme de 690 millions de dollars pour reconstruire le système de santé en Haïti.
Lors d'une réunion bilatérale prévue dans les prochaines semaines, qui sera conduite par Antônio Patriota, le nouveau Ministre brésilien des relations extérieures, chargé de coordonner les efforts, le Brésil et Cuba « chercheront d'autres moyens en vertu des accords existants, pour fournir une aide plus efficace et plus complète dans le domaine de la santé en Haïti » selon les propos de la présidente Dilma Rousseff.
Pere Miguel, l`espoir des enfants
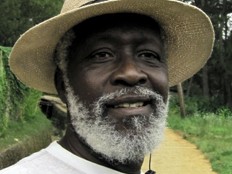 |
Au foyer Maurice Sixto, qui s’occupe de plus de 300 enfants à travers le territoire haïtien, voilà plus de vingt ans que l’on a fait du problème un vrai cheval de bataille. Voilà plus de vingt ans que le Père Miguel, fondateur du centre, encadre, éduque et aide ces « enfants sans enfance » à grandir. Sans relâche, le religieux milite pour la cause des « pauvres parmi les pauvres », mal nourris, mal traités, souvent logés dans des conditions effroyables.
Sur les hauteurs de Petite Rivière, dans le quartier de Carrefour, à Port-au-Prince, c’est l’effervescence. Entre rires et cris d’impatience, des dizaines d’enfants en costume se bousculent et prennent leur tour, accessoires et instruments de musique sous le bras, pendant qu’autant d’autres se pressent pour assister au “spectacle” préparé par leurs camarades. C’est la fête au foyer Maurice Sixto, et pas n’importe laquelle. En cette matinée ensoleillée, on célèbre bien sûr le passage dans une nouvelle année qu’on espère moins rude et traumatisante que la précédente, mais pas seulement. Aujourd’hui, c’est surtout la fête des enfants. Et plus particulièrement des plus pauvres et des plus démunis d’entre eux, ces « Restavek » (du créole « rester avec ») dont la vie de labeur, de maltraitance et de violences stigmatise un des drames silencieux qui traverse Haïti depuis des décennies. , ces enfants, souvent originaires des provinces et placés comme domestiques dans des familles d’accueil, seraient plus de 300 000 dans tout le pays.
« Les Restavek se lèvent avant tout le monde et le soir, ce sont les derniers à pouvoir aller se coucher, souvent à même le sol », explique-t-il, avant d’évoquer les maltraitances physiques, les sévices corporels ou les injures qui font le quotidien de ces jeunes. La petite Carine Mésidor en sait quelque chose. Originaire de Jérémie, dans l’ouest du pays, sa mère l’a placée il y a maintenant 6 ans dans la famille d’une « cousine » de Port-au-Prince, jamais rencontrée auparavant. Comme beaucoup de parents de ces contrées reculées, sa mère n’avait pas les moyens de l’élever ou de l’envoyer à l’école, alors elle a décidé de s’en séparer. Pour son bien, espérant que sa nouvelle famille pourrait la scolariser, en échange de travaux ménagers.
Une histoire commune à de nombreux « Restavek », dont le sort est souvent lié à la question de l’enclavement des provinces et à la crise du monde rural haïtien. « Il faut aider la paysannerie à se construire, développer l’arrière-pays ! À l’heure actuelle, 80% du territoire est complètement marginalisé ! Tant que rien ne sera fait pour valoriser les régions, les gens continueront de grossir les bidonvilles de Port-au-Prince et les enfants seront toujours placés dans des familles d’accueil. C’est une vraie question de société que nous ne pouvons plus ignorer. La population haïtienne doit en prendre conscience ! », martèle le Père Miguel. Depuis que Carine a quitté Jérémie, ses journées sont longues et ses nuits, bien courtes. « Les enfants de ma cousine vont à l’école et moi, je reste travailler à la maison », résume-t-elle à demi-mots, osant à peine mentionner les coups de fouet et autres brimades dont elle est l’objet « quand elle n’a pas bien fait [...] Mais au moins, eux, acceptent de me parler, pas comme les enfants d’amis de ma cousine, à qui on interdit de m’approcher », glisse-t-elle encore, les yeux sur ses chaussures.
Depuis un peu plus d’un an, la vie de Carine a pourtant changé. Sa famille d’accueil l’autorise à se rendre tous les après-midi dans le foyer Maurice Sixto où elle est scolarisée, tout en ayant accès à un panel d’activités musicales, sportives ou culturelles qui lui étaient interdites auparavant. Ce que Carine préfère ? « la danse », avoue-t-elle, le rose aux joues. Très assidue, elle essaie de ne jamais manquer un cours, et ce particulièrement depuis le 12 janvier dernier. « Je m’y rends encore plus souvent qu’avant », souffle la jeune fille, dont la maison d’accueil a été détruite.
Pourtant, la situation n’est pas simple au foyer depuis le tremblement de terre. Sur les deux maisons dont le centre disposait, l’une d’entre elles est totalement effondrée. Sans parler des morts et des disparus, trop nombreux. Mais pour le Père Miguel, pas question de se laisser déborder par les évènements. « Les enfants ont encore plus besoin de nous. Tous ont été très affectés et traumatisés par le séisme. En dépit des difficultés, il était indispensable de redémarrer aussi vite que possible, de leur redonner un cadre dans lequel ils puissent s’exprimer, évacuer leurs stress par le biais d’activités artistiques ou créatives. C’est un programme que nous avons conçu pour les enfants du centre, mais aussi pour tous les autres jeunes de Petite Rivière. Pour que tous les enfants puissent continuer à être des enfants. » Et les résultats sont étonnants. « Ici, les jeunes vont beaucoup mieux, alors que c’est malheureusement peu le cas ailleurs. Ils sont animés, actifs, plein de vie ! ». À regarder les jeunes courir d’un bout à l’autre de la scène improvisée, affairés aux préparatifs de la fête, on le croit volontiers. Un résultat particulièrement encourageant pour l’homme d’Église, dont le message adressé aux enfants en ce début d’année reste simple : « Nous voulons leur faire comprendre que nous ne les lâchons pas, que nous les accompagnerons toujours, pour qu’eux aussi puissent avoir droit à un avenir. En Haïti, nous vivons dans une réalité déconcertante, décourageante par bien des aspects, mais à notre propre niveau, on peut accomplir des choses merveilleuses ! ». Aujourd’hui, il est donc impératif de continuer. Et pour cela, il faut reconstruire. Avec le soutien du Secours Catholique et de son partenaire, Développement et Paix, le Père Miguel planifie déjà la remise en état du centre, la construction de 6 salles de classe et d’un bâtiment, entièrement dédié à la formation des enfants “Restavek”. Pour 2011, Carine a deux grands souhaits. Continuer à danser, et que la prochaine fête soit aussi belle.
1ere Transmission Internationale Reussie
 |
La compagnie vietnamienne Viettel, a annoncé dans un communiqué, que sa filiale en Haïti, «Natcom» [anciennement Téléco], avait réalisé avec succès, fin décembre 2010, sa première transmission internationale de voix, entre Haïti et le Vietnam sur son nouveau réseau mobile, construit aux normes internationales.
4 mois après le commencement des travaux de déploiement de son réseau cellulaire GSM / 3G [à partir de zéro], 5 BTS (Base Transceiver Stations) sont opérationnels. Parallèlement à la construction de son réseau mobile, la Natcom travaille au remplacement et à la reconstruction du réseau de lignes national, partiellement détruit et obsolète, afin d’offrir des services téléphoniques nationaux ultra-moderne, y compris l'accès internet à large bande DSL.
Natcom annonce également, avoir réalisé avec succès, des tests de transmission au niveau national sur ses nouveaux réseaux fixe, à fibre optique et mobile. Le réseau Natcom, n’est pas encore interconnecté avec les opérateurs de télécommunications en Haïti, la compagnie attend d’avoir complété l’installation des 1,000 BTS de son réseau mobile, ce qui devrait être fait dans le courant de 2011.
Rappel :
En avril 2010, la Compagnie Vietnamienne Viettel, filiale de l’armée vietnamienne, avait fait l'acquisition de 60% des actions de la Téléco, créant la compagnie Natcom en partenariat avec la Banque de la République d'Haïti, (BRH) qui détient l’autre 40%.

